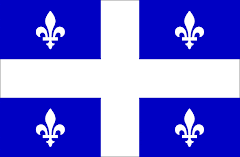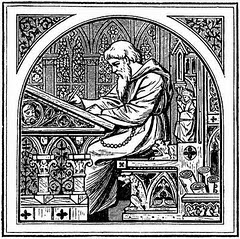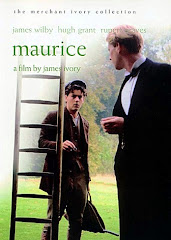Loin de m'inquiéter, la nouvelle m'intriguait. Je trouvais que depuis la veille, sans que j'aie fait quoi que ce soit pour qu'il en soit ainsi, ma vie avait pris une tournure intéressante. Je n'étais plus le maître à bord, qui acquiesce ou qui rejette ce qu'on lui propose ; ou plutôt : je m'abandonnais totalement à ce qui m'arrivait. Tout le monde autour de moi (les médecins, les infirmières, les préposés) semblait savoir ce qu'il faisait et ils me semblaient tous avoir à coeur mon plus grand bien, celui de faire en sorte que la douleur avec laquelle j'étais arrivé ne soit plus là à mon départ et ne revienne plus jamais. Sans inquiétude et sans question superflue, je m'abandonnais en toute confiance et je prenais plaisir à découvrir au fur et à mesure ce qui m'arrivait. Je ne dirais pas que j'observais tout cela avec le regard objectif du journaliste ou avec la curiosité du scientifique ; j'étais plutôt amusé d'être au centre d'une expérience dont j'étais l'objet principal. Que je ne sois pas l'objet d'une expérience unique ne me touchait pas du tout, que d'autres aient vécu cela avant moi ne m'importait pas (j'en étais plutôt rassuré) ; ce que je trouvais intéressant, c'était que cela m'arrive à moi.
Ayant retrouvé mon lit-voiture, sur lequel on me transportait d'une salle, d'un étage, d'un pavillon à l'autre, je repris la direction de l'urgence, toujours aussi bien conduit par un jeune homme ou une jeune fille qui devrait donner des leçons de conduite à nos automobilistes aussi irrespectueux qu'irresponsables. Arrivé à l'urgence, on me dit qu'on allait m'installer dans un coin un peu plus tranquille ; quand j'y fus, je me suis rendu compte que j'étais toujours à l'urgence, mais dans l'une des salles d'observation. On m'installa au bout d'une pièce ; à ma gauche, il y avait donc un mur et, à ma droite, trois voisins, séparés les uns des autres par un rideau. Je me reposai un peu puis, m'étant fait une idée des lieux, j'entrepris d'aller explorer un peu, question de passer le temps et de voir ce qui se tramait autour. Grâce aux injections de morphine, je ne ressentais plus de douleur. Un infirmier avait senti que je n'avais pas envie de rester toujours au lit ; il m'offrit une deuxième de ces blouses sans bouton qui laissent à découvert les fesses de tous les patients, riches ou pauvres, beaux ou laids ; j'enfilai la deuxième blouse par-dessus l'autre, mais avec l'ouverture en avant cette fois : je pouvais alors circuler sans devoir tenir les bords de la blouse pour éviter qu'elle ne s'ouvre trop grand. Puis ce fut l'heure du repas. Comme j'avais fait tous les tests possibles, je n'avais plus besoin d'être à jeun. J'ai donc eu droit à une soupe légère, à une assiette de boeuf au jus avec une purée de carottes et des haricots jaunes, puis à une crème caramel avec du thé (ou ce que l'on appelle du thé dans les hôpitaux : une tasse de plastique contenant de l'eau chaudasse dans laquelle on dépose soi-même un sachet de poussière de thé). À l'exception du thé, le reste était bon et comme je n'avais pas mangé depuis vingt-quatre heures, j'étais content.
La soirée s'est passée un peu comme avant le repas. J'alternais les promenades dans les couloirs environnants et les périodes de repos où, allongé sur mon lit, j'écoutais les conversations des voisins, essayant de comprendre pourquoi ils étaient là, qui ils étaient... Puis, la fatigue aidant, mes périodes de repos et de sommeil étaient de plus en plus longues, interrompues parfois par la visite d'une infirmière ou d'une technicienne venant chercher des renseignements pour mon dossier de candidat à la chirurgie. À vingt-trois heures, alors que je dormais, je sentis que mon lit commençait à bouger ; le préposé qui ne voulait pas me réveiller m'annonça qu'on m'avait trouvé une place dans une chambre, au quatrième, et qu'il allait m'y conduire. En arrivant dans la chambre, je vis un jeune homme qui se tordait de douleur sur un lit auprès duquel on allait rouler le mien. Le préposé prononça quelques mots d'excuses à l'intention du jeune homme, qui ne semblait pas trop conscient de ce qui se passait autour de lui ; il avait assez de sa souffrance pour ne pas avoir à s'intéresser à celle des autres. Toute la nuit, je l'entendis gémir, pleurer, vomir, crier son découragement devant cette souffrance qui ne le quittait pas, en dépit de tous les médicaments qu'on lui faisait ingurgiter. J'appris le lendemain qu'il souffrait ainsi depuis deux semaines, seul chez lui, et qu'il venait de se décider à se rendre à l'hôpital. Les derniers tests révélaient que, depuis quelques semaines, il était porteur du VIH ; la fièvre était haute (sa température se maintenait autour de trente-neuf degrés), la migraine était constante et insupportable et les nausées ne lui laissaient pas beaucoup de répit. Je me considérais heureux de n'avoir malgré tout qu'un léger problème dont on allait bientôt me débarrasser.
À six heures, on vint me donner des médicaments, me faire des injections, me donner quelques instructions pour me préparer à la chirurgie. J'écoutais attentivement tout ce qu'on me disait et je suivais à la lettre les instructions, comme l'élève docile que j'ai d'abord été... avant de devenir le doux délinquant que je suis. Je devais être à jeun. Je fis ma toilette et je restai allongé dans mon lit en attendant que l'on vienne me chercher. À neuf heures, on commença à s'affairer : on m'attendait à la salle d'opération et l'infirmière devait encore me donner une injection, ce qu'elle fit dans le couloir alors que, sur mon lit roulant, j'étais en route vers un autre pavillon, où j'avais rendez-vous avec mon mystérieux personnage.
On me fit emprunter plusieurs couloirs, quelques ascenseurs ; puis je franchis plusieurs portes ; de plus en plus la température des couloirs était froide. Finalement, on m'immobilisa dans un grand hall ; une femme charmante vint me voir, se présentant comme l'anesthésiste, me posa quelques questions pour évaluer les difficultés et les risques qui pourraient se présenter. Pendant ce temps-là, j'avais entendu dans les hauts-parleurs qu'on avait appelé mon chirurgien ; fidèle à son personnage, il arriva comme sur un nuage ; je le vis devant moi, debout, silencieux, les bras croisés, un léger sourire aux lèves qui semblait dire : « Comment, vous m'avez appelé et vous n'êtes pas prêts ? » L'anesthésiste murmura un bref : « Plus qu'une minute, Docteur X. » Puis on me conduisit dans un salle blanche, immaculée, éclairée comme s'il devait s'y passer quelque chose d'important. C'est assez impressionnant, une salle d'opération, surtout quand on la regarde d'en bas. L'anesthésiste et son assistante s'amusèrent en me faisant la conversation et, étrangement, j'avais toujours ce sentiment de me trouver dans un conte. L'anesthésiste, d'un air taquin, demanda à son assistante si elle n'avait pas remarqué qu'il manquait quelque chose dans cette salle d'opération. « Quoi donc ? », osa candidement l'assistante. « Un masque pour le patient », finit par répondre l'anesthésiste, en riant. On trouva le masque, qu'on m'appliqua sur la bouche et le nez en me disant qu'on allait m'injecter des médicaments avec de l'oxygène et en me demandant de penser à quelque chose d'agréable ; durant quelques secondes, j'eus le temps de penser à quelques personnes que j'aime, puis... à la Provence et... plus rien.
Je me réveillai dans une autre salle ; pendant quelque temps, je crus que le conte était terminé. J'éprouvais quelques douleurs, au cou, aux épaules ; ce n'étaient que des tensions. J'étais un peu impatient et la personne qui était chargée de me surveiller avait beau répéter que c'était normal après une anesthésie, une opération, je ne comprenais pas pourquoi elle ne s'empressait pas de me soulager, de me masser le cou, les épaules. Enfin, on vint me chercher pour me conduire à ma chambre, où j'ai passé le reste de la journée à dormir, à répondre aux questions des infirmières, à faire ce que l'on me demandait de faire, à prendre ce que l'on me donnait. Puis j'appris que je pouvais aussi demander si je voulais quelque chose ; si j'avais mal, il ne fallait pas attendre que la douleur soit trop grande ; il fallait le dire et on me soulagerait aussitôt. « Soulager », cela semble le mot magique de tout le milieu médical ; tout le monde l'emploie. Je n'en abusai point, mais j'eus ma part de soulagement.
Suite et fin au prochain épisode.